Une culture des transitions, c’est l’hypothèse selon laquelle les transitions sont moins une affaire technique, académique ou réglementaire, qu’une affaire culturelle.
Pour une culture des transitions (supplément Technikart)
Nous ne bâtirons pas des politiques publiques en mesure de limiter drastiquement l’artificialisation des sols, la destruction de la biodiversité ou l’usage inconsidéré des ressources naturelles, sans une réflexion sur les transformations culturelles induites sur nos modes de vie, nos valeurs, nos représentations, nos imaginaires, nos mythes. Sans éprouver collectivement d’autres modes de faire, d’autres récits de territoire, d’autres manières d’habiter et de penser les rapports que nos sociétés entretiennent avec le vivant humain et non humain. Sans nous désintoxiquer d’un imaginaire aménageur fondé sur la compétitivité, l’attractivité, l’extension sans limite des métropoles et la vision d’une économie désencastrée des contingences sociales, écologiques et territoriales. Sans que le substrat culturel de nos sociétés ne soit préparé et aligné sur des transformations qui s’avèrent radicales.
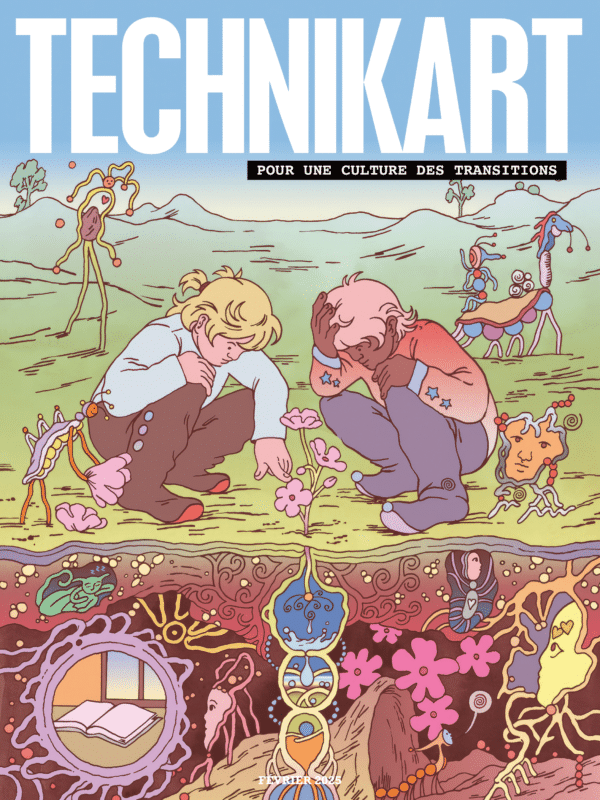
Une culture des transitions, c’est la prise de conscience des limites des approches académiques, réglementaires et techniques des transitions. Une prise de conscience fondée sur un triple constat:
1) L’accumulation des rapports scientifiques du Giec ou de l’IPBES n’a pas eu d’effet sur l’augmentation de la capacité de nos institutions et des individus à agir et à se transformer. Bien au contraire! Face à l’angoisse suscitée par la tragédie de nos « à-venir », nous bricolons de merveilleuses stratégies d’évitement, qui agissent souvent à l’envers des recommandations des savoirs experts et académiques.
2) Les politiques publiques des transitions (les objectifs de
zéro artificialisation nette – ZAN – les zones à faibles émissions – ZFE – les plans climat-air-énergie territorial – PCAET –, etc.) se heurtent à des cortèges d’élus populistes qui examinent ces dispositifs réglementaires comme autant de lois imposées depuis le « sérail des élites parisiennes ». Ces lois seraient « ruralicides », « antisociales » et s’apparenteraient à « des bombes à fragmentation bureaucratique et liberticide, dont les premières victimes seront les classes populaires et moyennes ». Et force est de constater que ces élus, relayés par de puissants médias de masse, ont réussi. Ils ont réussi à créer l’illusion d’une opposition entre le social et l’écologique et à monter un conflit artificiel entre les classes populaires, les « zadistes » et autres « wokistes ». Ils ont réussi à populariser l’idée selon laquelle les plus défavorisés seraient les plus grands perdants des politiques de transition écologique. Or, les analyses socio-économiques montrent exactement l’inverse. « La non-transition écologique – c’est-à-dire la situation actuelle dans laquelle les crises écologiques s’aggravent sans trouver de réponse adéquate – est génératrice d’inégalités sociales qui touchent d’abord les plus démunis. »3) Les outils technologiques et la fascination béate de nos sociétés pour l’intelligence artificielle (IA) ne sauraient constituer des réponses sérieuses aux défis des transitions. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer l’envers de l’IA, les travailleurs du clic, les surconsommations énergétiques induites et l’émergence hautement probable d’individus aliénés et incapables de développer leurs propres intelligences. Nos sociétés obsédées par le solutionnisme technologique, omettent trop souvent de regarder l’envers de la puissance. Or, il serait imprudent d’oublier que « les civilisations qui élèvent le plus orgueilleusement leurs cités composent en même temps leurs doubles souterrains, un puit pour chaque tour, un égout pour chaque palais, pour chaque ville de lumière une ville d’ordures, avec ses colosses et ses pyramides ».
Une culture des transitions, c’est la conviction que les arts et la culture ont un rôle décisif à jouer dans les transformations sociétales. Une conviction étayée par l’existence d’une multitude d’artistes, de collectifs, de centres d’art, de bibliothèques, de centres de culture scientifique, de maisons de l’écologie, de tiers-lieux culturels, d’acteurs de l’urbanisme culturel ou de l’économie sociale et solidaire, qui œuvrent à la décarbonation de la filière culturelle, à l’écriture collective de nouveaux récits, à l’invention d’imaginaires et d’expériences alternatives qui contribuent à la transformation des territoires et à leur meilleure habitabilité. Bien que leurs pratiques divergent, ces acteurs se retrouvent dans une conception élargie de la notion de culture, qui englobe, « outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».
Une culture des transitions, c’est réapprendre à faire de la politique avec la culture pour inventer une écologie locale et populaire, en mesure de s’incarner dans les lieux de vie ordinaire et les besoins socioculturels et matériels des individus. C’est bâtir des politiques culturelles des transitions territoriales, des politiques de transition « justes », capables de résoudre localement les équations entre les exigences socio-économiques, culturelles et environnementales. C’est rêver de l’émergence d’un mouvement politique en mesure de défendre les idées d’auto-gestion, d’encapacitation citoyenne, de droits culturels, de citoyenneté économique, de communs, d’entrepreneuriat de territoire, de décentralisation, de micropolitique du quotidien, pour permettre l’avènement d’une démocratie du faire. Un mouvement politique animé par le désir d’émancipation des individus et la possibilité donnée à tout un chacun de pouvoir agir en bas de chez soi et d’inventer des solutions alternatives et ré-enchantées, face aux lectures mortifères des transitions et aux régressions identitaires, nationalistes et libertariennes.
Une culture des transitions, c’est refaire de la politique tout court. L’un des grands enseignements de ce numéro de Technikart.
Raphaël Besson
directeur de Villes Innovations, chercheur associé au laboratoire PACTE,
co-fondateur du Laboratoire d’usages Culture(s) Arts
Société et auteur de l’ouvrage Pour une culture des transitions (Editions du
LUCAS, 2024) dont le titre du présent numéro est tiré.

Lire le Technikart:
https://communication-responsable.ademe.fr/publication-technikart-pour-une-culture-des-transitions